Nicolas-Bernard Lépicié
Cliquer sur les images ci-dessus
PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.
Patrick AULNAS
Autoportraits
Nicolas-Bernard Lépicié. Autoportrait (v. 1777)
Huile sur toile, 91 × 72 cm, musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne.
Nicolas-Bernard Lépicié. Autoportrait (v. 1780)
Huile sur toile, 73 × 59 cm, musée Carnavalet, Paris.
Biographie
1735-1784
Nicolas-Bernard Lépicié naît le 16 juin 1735 à Paris. Son père, Bernard François Lépicié (1698-1755), graveur et poète, devient académicien en 1740. En 1723, il avait épousé Renée-Élisabeth Marlié (1714-1773) également graveuse. Très jeune, Nicolas-Bernard étudie donc la gravure en famille. Mais sa vue ne lui permet pas de poursuivre dans cette voie. Il faut en effet une acuité visuelle parfaite pour graver au burin sur le cuivre des sillons minuscules. Le jeune artiste se dirige alors vers la peinture et devient l’élève de Carle van Loo. Concourant pour le Prix de Rome en 1759, il obtient le deuxième prix.
Nicolas-Bernard Lépicié expose pour la première fois au Salon de peinture et de sculpture en 1765 avec un tableau monumental de plus de huit mètres de largeur, La descente de Guillaume le Conquérant sur les côtes d’Angleterre, qui lui permet d’être agréé par l’Académie royale. L’artiste continue à exposer au Salon les années suivantes. Mais, influencé par Jean-Siméon Chardin et la peinture néerlandaise, il s’oriente également vers les scènes de genre et le portrait. Tableau de Famille est un succès au Salon de 1767.
Nicolas-Bernard Lépicié. Portrait de la famille Leroy (1767)
Huile sur toile, 136 × 147 cm, musée Pouchkine, Moscou.
Il fallait une scène mythologique ou religieuse pour accéder au rang d’académicien. Nicolas-Bernard Lépicié est admis comme membre de l’Académie Royale de peinture et sculpture en 1769 avec comme morceau de réception Achille instruit dans la musique par le centaure Chiron. Il devient professeur en 1779. Jusqu’à sa mort prématurée en 1784, le peintre poursuivra conjointement la peinture d’histoire, le portrait et la scène de genre. Une crise religieuse et une fragilité pulmonaire l’amèneront à vivre fréquemment à la campagne à la fin de sa vie. Il meurt à Paris le 15 septembre 1784 à l’âge de 49 ans.
Nicolas-Bernard Lépicié. Le petit dessinateur : le peintre Carle Vernet à l'âge de quatorze ans (1772)
Huile sur toile, 41 × 33 cm, musée du Louvre, Paris.
Œuvre
L’œuvre de Nicolas-Bernard Lépicié comporte des thèmes historiques, mythologiques et religieux, des paysages, des portraits et des scènes de genre. Il appartient donc à cette catégorie d’artistes capables d’embrasser tout le spectre de l’art de peindre. A ses débuts, le style rococo, qui avait dominé le 18e siècle en France, est sur le déclin et le néoclassicisme a le vent en poupe. Le travail de Lépicié se rattache nettement à cette tendance. Très célèbre et très apprécié au 18e siècle, académicien, professeur, il se distingue dans sa jeunesse par ses grandes toiles historiques.
Nicolas-Bernard Lépicié. La descente de Guillaume le Conquérant sur les côtes d’Angleterre (1765)
Huile sur toile, 400 × 845 cm, Abbaye aux Hommes, Caen.
Mais c’est surtout par ses scènes de genre, se rapprochant parfois du portrait, qu’il marque l’histoire de l’art. Les historiens évoquent souvent la parenté de son œuvre avec celle de Chardin, pour le réalisme paisible et intemporel, et avec celle de Greuze, pour le caractère édifiant de certaines scènes.
Nicolas-Bernard Lépicié. Le repos (1776)
Huile sur toile, 65 × 53 cm, collection particulière.
Nicolas-Bernard Lépicié. Les accords (1774)
Huile sur toile, 49 × 60 cm, musée de Grenoble.
Ses remarquables paysages ruraux ou urbains, représentant l’activité humaine, sont inspirés de la peinture néerlandaise et flamande.
Nicolas-Bernard Lépicié. Cour de ferme (1784)
Huile sur toile, 64 × 77 cm, musée du Louvre, Paris.
Huiles sur toile
|
Nicolas-Bernard Lépicié. La descente de Guillaume le Conquérant sur les côtes d’Angleterre (1765). Huile sur toile, 400 × 845 cm, Abbaye aux Hommes, Caen. Le tableau illustre la bataille d’Hastings (1066), épisode de la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie. Le dernier roi saxon, Harold Godwinson (1022-1066), est vaincu et trouve la mort au cours de la bataille. Le livret du Salon de 1765 indique que Guillaume « exhorte son armée à vaincre ou à mourir ; et pour déterminer ses soldats par le coup le plus hardi, il fixe leur attention sur la flotte en feu. La célèbre bataille de Hastings, qui en fut le fruit, décida du sort de l’Angleterre ; et par la mort de Harald, qui y fut tué, Guillaume se vit possesseur du trône. » |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Portrait de la famille Leroy (1767). Huile sur toile, 136 × 147 cm, musée Pouchkine, Moscou. Intitulé Tableau de Famille au Salon de 1767, cette composition s’apparente aux œuvres édifiantes de Greuze. Un prêtre lit la Bible à une famille bourgeoise rassemblée, en levant un doigt pour marquer l’importance du propos. Les visages sont sereins mais très attentifs. La présence des enfants, du chat et du jouet est nécessaire pour éviter le rigorisme moralisateur. |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Achille instruit dans la musique par le centaure Chiron (1769). Huile sur toile, 142 × 195 cm, musée des Beaux-arts de Troyes. Mythologie grecque. Chiron est un centaure, créature mi-homme mi-cheval, immortel et réputé pour sa sagesse. Sa vie dans la nature lui ayant permis d’acquérir de vastes connaissances, on fait appel à lui comme précepteur. Parmi ses nombreux disciples figure Achille, héros légendaire de la guerre de Troie. Il est représenté ici apprenant la lyre, Chiron lui prodiguant ses conseils. Ce tableau est le morceau de réception de Lépicié à l’Académie Royale de peinture et de sculpture, dont il devient membre le 1er juillet 1769. |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le jeune dessinateur (1769-72). Huile sur toile, 55 × 46 cm, musée du Louvre, Paris. Le thème du jeune dessinateur a été fréquemment utilisé au 18e siècle en France. « Généralement, sont figurés des enfants âgés de huit à quinze ans, vus à mi-corps et vêtus d’une veste et d’un chapeau, d’ordinaire un tricorne, alors particulièrement à la mode. La neutralité du fond confère une certaine intemporalité aux garçons portraiturés […] Les jeunes dessinateurs, souvent anonymes et vus dans un cadrage serré, ne se tiennent habituellement pas face au spectateur, mais inclinent la tête et le regardent. Ils tiennent généralement dans leurs mains un carton à dessins et un porte-crayon dans lequel est disposée une sanguine ou une pierre noire, mais l’estompe n’est jamais représentée » (Extrait de La représentation du jeune dessinateur, Cairn. Info) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. La Paix (1772). Huile sur toile, 129 × 90 cm, musée Ingres-Bourdelle, Montauban. « Cette œuvre appartient probablement à une série de "quatre ou cinq tableaux représentant chacun une figure allégorique ", faite pour l'École militaire à Paris en 1772 (dans laquelle il y aurait un Louis XV en Apollon, Henri IV en Mars, Marie Leszczinska en Junon ; l'allégorie de la Paix représenterait Marie de Médicis). Cette série est envoyée au musée des Monuments français, dépôt des Petits-Augustins, le 16 avril 1794. |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le petit dessinateur : le peintre Carle Vernet à l'âge de quatorze ans (1772). Huile sur toile, 41 × 33 cm, musée du Louvre, Paris. Charles Horace Vernet, dit Carle Vernet (1758-1836), est un peintre de scènes de genre et l’élève de Nicolas-Bernard Lépicié. Il est aussi le fils du grand peintre de paysages Joseph Vernet (1714-1789). |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Les accords (1774). Huile sur toile, 49 × 60 cm, musée de Grenoble. « Présenté au Salon de 1775 sous le titre Les Accords puis gravé par Antoine François Hémery en 1777 et intitulé La Promesse approuvée, ce tableau de Lépicié illustre à merveille le goût pour les scènes de genre dans la peinture française de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. De fait, artiste discuté dans le registre de la peinture d’histoire, Lépicié est en revanche unanimement apprécié pour ses œuvres intimistes qui renvoient le plus souvent au monde paysan. C’est le cas de cette belle composition qui témoigne avec grâce du réalisme sensible et de la virtuosité délicate de ce maître. Trois personnages animent cette scène qui se situe dans une cuisine de ferme. Une femme portant un tablier blanc assise entre une jeune fille vêtue d’une robe rayée gris et rose, à sa droite, et un jeune homme en veste et culotte beige, à sa gauche, unit leurs mains sur ses genoux. Les deux jeunes gens se regardent avec une tendre ferveur, tandis que la mère de la promise incline légèrement la tête vers le jeune homme en signe de consentement. Rien d’affecté dans ces personnages, mais au contraire une vérité de la scène et une sincérité des êtres qui font de cette œuvre une illustration émouvante de ce peuple des campagnes que Lépicié, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, a aimé et voulu dépeindre. Une fine lumière filtre d’une fenêtre à gauche et illumine de sa chaude clarté la pénombre de la pièce. L’artiste s’est plu à détailler avec précision les meubles, les ustensiles et les objets qui occupent cet intérieur et forment comme une allégorie des bonheurs simples du foyer. De la miche de pain sur le buffet aux feuilles de choux laissées à terre, du brasero rougeoyant au panier à couture rangé sous la table, c’est toute une vie domestique qui est évoquée avec une poésie qui n’est pas sans rappeler la peinture hollandaise du siècle d’or. » (Commentaire musée de Grenoble) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. La cour de la Douane (1775). Huile sur toile, 98 × 164 cm, Musée national Thyssen-Bornemisza, Madrid. « La présente toile, signée et datée de 1775, est une œuvre de maturité de Lépicié. L’artiste a organisé sa composition, très admirée, à travers un grand espace ouvert s’achevant sur la gauche par un portique incurvé d’arcades et une petite galerie abritant les bureaux de la Maison des Douanes. L’espace au milieu de la cour est rempli de paquets, de balles et de tonneaux chargés sur des chariots ou posés sur le sol. Entre eux, nous voyons les chevaux de trait et les personnages, ces derniers disposés en groupes et attendant ou examinant la marchandise ; par exemple, le groupe au premier plan ouvrant une caisse de livres. D’autres supervisent les balles, vérifient les scellés et la documentation, comme dans le groupe central. L’activité qui se déroule dans la cour, par laquelle l’artiste dépeint les tâches quotidiennes des douaniers, semble être une représentation réaliste du travail de cette administration, bien que dans la version de Lépicié, l’abbé Terray lui-même, vêtu de noir et debout derrière l’homme à la redingote rouge, supervise personnellement les travaux. La gamme chromatique harmonieuse est rompue par des touches saturées de rouges et de verts dans les vêtements de certaines des figurines. » (Commentaire musée Thyssen-Bornemisza) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le repos (1776). Huile sur toile, 65 × 53 cm, collection particulière. « Le tableau s’inspire de deux autres tableaux de Lépicié : Le voyageur de campagne, qui sera présenté au Salon de 1773 et Le Vieillard voyageur, exposé au Salon de 1783. Dans la première composition figure un chien en lieu et place de l’enfant endormi du Repos. Ce petit garçon est le modèle favori du peintre, un élève probablement, (le jeune Carl Vernet ?). On le retrouve dans plusieurs de ses toiles, toujours avec les mêmes vêtements, dans La Bouillie ainsi que dans la composition des Mendiants de l’ancienne collection Lütz. (E. Coatalem, Hommage à la Galerie Cailleux, 2015) » (Commentaire Unipictura18) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le Dévouement de Porcia, femme de Junius Brutus (1777). Huile sur toile, 323 × 259 cm, Palais des Beaux-Arts de Lille. « Fille du stoïcien Caton d’Utique, Porcia devine que son mari a l’intention de tuer Jules César. Pour exciter son courage, elle décide de s’entailler la cuisse. Commande de la Manufacture Royale des Gobelins, cette peinture est une importante création néoclassique de Lépicié en tant que peintre d’histoire. » (Commentaire PBA Lille) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. La leçon de lecture (1774-79)
« Les figures d’une mère apprenant à lire à sa fille et de son pendant représentant une mère allaitant son bébé, sont tirées de tableaux plus grands de l’artiste : La Bonne Maison d’environ 1774, gravé par Longueil en 1788, et L’Atelier du charpentier, exposé au Salon de 1775 et gravé par Le Bas (tous deux perdus). Ces deux pendants semblent avoir été peints pour Le Bas qui les a gravés sous les titres Le devoir maternel et L’éducation commencée. Les thèmes du devoir maternel et de l’éducation de l’enfant mettent en évidence les rôles familiaux traditionnels, que les réformateurs du XVIIIe siècle comme Rousseau considéraient comme essentiels au bien-être moral de la nation. » (Commentaire Wallace Collection) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Portrait de Quatremère et de sa famille (1780). Huile sur toile, 53 × 62 cm, musée du Louvre, Paris. « Le tableau est un hommage de Lépicié à son ami Quatremère, marchand de drap engagé dans le mouvement janséniste. C'est une rare expression de la tendresse paternelle, attitude nouvelle à l'égard des enfants en bas âge. » (Commentaire Réunion des Musées nationaux) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Cour de ferme (1784). Huile sur toile, 64 × 77 cm, musée du Louvre, Paris. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827) a commandé ce tableau évoquant une ferme modèle implantée sur ses terres. Il s’agit de l’une des dernières œuvres de l’artiste. « Lépicié représente la cour d’une ferme typique du Bassin parisien. Les bâtiments visibles sur cette toile sont la grange aux foins au fond et le corps de ferme à droite. Ils sont en pierre calcaire et couverts de tuiles. La lumière jaune chatoyante et les jeux d’ombre suggèrent un après-midi d’automne. L’artiste agrémente ce petit tableau de multiples saynètes qui l’animent et le rendent réaliste. Huit personnages s’affairent à des tâches diverses. » (Commentaire Histoire-Image.org) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Mathatias tue un juif idolâtre et l’officier du roi Antiochus (1784). Huile sur toile, 325 × 261 cm, musée des Beaux-arts de Tours. « La commande de ce tableau s’inscrit dans le vaste programme mis en place à partir de 1776 par d’Angiviller (directeur général des Bâtiments du roi) qui, souhaitant "ranimer le genre noble et sévère de l’Histoire", fait réaliser chaque année, pour le compte des bâtiments du roi, plusieurs tableaux "dans le genre de l’Histoire". […] |
Dessins et gravures
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le Petit Savoyard ou l'enfant endormi (v. 1777). Pierre noire, estompe, rehauts de craie blanche et de sanguine, sur papier beige, 32 × 26 cm, musée du Louvre. « Plutôt un petit cireur de chaussures. Ce motif de l'enfant endormi est courant chez Lépicié, qui l'a associé à la figure d'un vieil homme assis, créant ainsi une scène de genre, Le Repos (tableau du Salon de 1777, n° 15, première variante au Salon de 1773, n° 32 et réplique au Salon de 1783, n° 7). Le Repos a été gravé par Clément Bervic en 1777 avec une dédicace au comte et à la comtesse de Brancas puis exposé au Salon de 1785, n° 312. Un dessin aquarellé de la même composition est passé en vente à Cologne le 14 mai 1994. L'enfant endormi, étude pour Le Repos, figure au Catalogue raisonné de l'œuvre peint et dessiné de N.B. Lépicié, par Philippe Gaston-Dreyfus, n° 420 (1923). » (Commentaire musée du Louvre) |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Le repos (1777). Estampe (gravure sur cuivre), feuille 45,2 × 36,5 cm, Harvard Art Museums, Cambridge, Massachusetts. Gravure réalisée par Charles Clément Bervic (1756-1822) en 1777 d’après le tableau de Lépicié de1776 (voir ci-dessus). Dédicace au-dessous de l’image : « Dédié à Monsieur le Comte et à Madame la Comtesse de Brancas. » |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. La Vierge, à genoux et tenant un rouleau, enseigne à lire à Jésus (1765-84). Encre brune à la plume, lavis, pierre noire, rehauts de blanc, 37,5 × 25,7 cm, musée du Louvre, Paris. |
|
Nicolas-Bernard Lépicié. Homme nu assis tourné vers la droite (1765-84). Fusain, estompé, pierre noire rehaussée de blanc sur papier gris-vert, 51 × 34 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. |
Pour visionner d'autres œuvres sur GOOGLE ARTS & CULTURE, cliquer sur le nom du peintre :
Ajouter un commentaire


























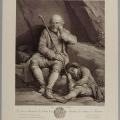
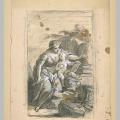
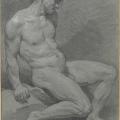
 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa